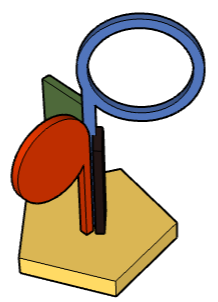Un nouveau cadre universel invite à repenser les approches en sciences sociales et humaines.
À nous autres chercheurs en intelligences,
Il est sans doute rare de tomber sur un document qui, tout en semblant si ancré dans une problématique, éveille en même temps des interrogations théoriques profondes. Le Méta-Processus Principiel (MPP), élaboré par DEDIĈI, est précisément de cette nature. Ce cadre, à la fois conceptuel et opérationnel, propose une nouvelle lecture de la solidarité et des dynamiques collectives. En parcourant ses principes, ses rôles et son architecture, un étonnement persistant m’a accompagné : comment une telle simplicité apparente peut-elle renvoyer à des questions si essentielles sur nos façons de concevoir les interactions humaines en matière de solidarité ?
Un langage universel pour organiser l’imprévisible
Le Méta-Processus Principiel s’articule autour de cinq rôles fondamentaux, associés à des principes universels. Cette structuration, bien que pensée pour organiser des réponses solidaires, résonne avec des notions clés en sociologie et anthropologie : celle de l’articulation des rôles sociaux (Goffman), des systèmes adaptatifs complexes (Morin), ou encore des invariants universels (Levi-Strauss). La promesse du MPP est celle d’un cadre applicable à des contextes aussi divers que les réseaux locaux de solidarité, les institutions globales, ou encore les collectifs informels.
Le plus intriguant est la posture qu’il nous invite à adopter : ne pas imposer une rigidité hiérarchique mais laisser émerger, au cœur même des interactions humaines, un ordre auto-organisé. Cette approche me rappelle les mécanismes d’auto-organisation observés dans la nature, mais ici transposés aux réalités sociales.
Un outil ou une métaphore ?
Le document parle à la fois à l’imaginaire et à l’opérativité. La description fractale du MPP, sa capacité à se reproduire à différentes échelles tout en restant fidèle à ses principes, ouvre une question fascinante : est-ce seulement un outil pour agir ou également une métaphore pour comprendre ? Si les cinq rôles tenus par la personne vulnérable, ses défenseurs, ceux qui s’occupent de sa situation, les intervenants et les institutions permettent d’organiser des réponses concrètes, ils décrivent aussi une manière d’être au monde. Chaque acteur social, à des moments différents, pourrait incarner et tenir tour à tour ces rôles, participant à un équilibre collectif.
Pourrait-on alors utiliser ce cadre pour analyser non seulement des organisations solidaires, mais aussi des écosystèmes sociaux plus larges ? Par exemple, dans quelles conditions un acteur passe-t-elle du rôle de défenseur à celui d’intervenant ? Quels sont les facteurs qui permettent ou empêchent une institution d’assumer pleinement son rôle de soutien ? Ces pistes, esquissées dans le modèle, mériteraient d’être approfondies par des recherches empiriques et comparatives.
Un terrain fertile pour l’anthropologie et la sociologie
Le Méta-Processus Principiel ne se limite pas à offrir un cadre d’adhésion. Il pose en filigrane des questions fondamentales : qu’est-ce qui rend une organisation humaine cohérente ? Quels sont les invariants qui permettent à une communauté de répondre aux défis du vivant ? Ces interrogations rejoignent directement les problématiques anthropologiques sur la reliance, l’interconnexion, et les rôles dans les systèmes sociaux.
En tant que chercheurs, nous pourrions utiliser cet outil pour des études de cas. Comment ces rôles s’articulent-ils dans une communauté indigène confrontée à des transformations environnementales ? Ou dans des mouvements sociaux qui luttent pour leur reconnaissance ? En quoi les principes du MPP pourraient-ils éclairer des pratiques ancestrales de solidarité, aujourd’hui redécouvertes sous d’autres formes ?
Entre science et action
Une des forces du document en lien réside dans sa double nature : il est à la fois un outil de réflexion théorique et une proposition d’action. Cette tension invite à explorer une intersection trop peu étudiée entre sciences sociales et pratiques organisationnelles. Comment une théorie, ancrée dans les besoins concrets des personnes vulnérables, peut-elle enrichir nos cadres théoriques ? Et inversement, comment nos travaux académiques pourraient-ils affiner, enrichir, ou tester les propositions de ce Méta-Processus ?
Il est facile de voir comment cette approche pourrait transformer les systèmes de gouvernance, mais l’intérêt pourrait être tout aussi fort pour des recherches fondamentales. Par exemple, le concept de triade d’autodétermination – réunissant la personne vulnérable, ses défenseurs, et ceux qui s’occupent de sa situation – pourrait devenir un prisme pour revisiter des notions comme la famille, l’autonomie, l’interdépendance, ou la reconnaissance sociale.
Et après ? Une invitation discrète à explorer
Je m’interroge encore sur la manière dont ce Méta-Processus Principiel peut être intégré dans nos travaux. Il semble offrir bien plus qu’un simple cadre de gestion : c’est une invitation à repenser la solidarité, à explorer les liens invisibles qui structurent nos interactions, et à poser des bases pour de nouvelles expérimentations.
En lisant ce document, j’ai eu la sensation de toucher une forme d’évidence, un « pourquoi n’y avons-nous pas pensé plus tôt ? ». Et pourtant, il reste encore tant à comprendre, tant à interroger. À tous, je laisse cette pensée : peut-être est-ce là une opportunité de s’arrêter, non pour conclure, mais pour commencer.