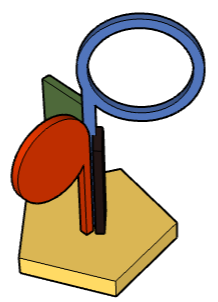l’alliance entre solidarité citoyenne et institutionnelle
Handicap, vieillissement
La vulnérabilité, qu’elle soit liée à l’âge, au handicap ou à des situations de vie complexes, interroge notre capacité collective à organiser des réponses humaines, durables et adaptées.
Les parents, les aidants et les acteurs de la solidarité partagent une intuition forte : la qualité de vie des personnes vulnérables dépend de la présence d’un cercle de confiance, à la fois proche dans l’humanité et soutenu par des institutions. Ils ont l’intuition également que ces cercles doivent exister et bien fonctionner partout où la personne est et partout où elle sera (en établissements ou en inclusion société) pour garantir le contexte de leur autodétermination.
Pourtant, ces cercles, quand ils existent, sont souvent fragiles, informels et leur pérennité devrait reposer sur une coordination rare entre acteurs de terrain et structures publiques.
Comment transformer cette intuition en action ? Comment construire, dès aujourd’hui, des alliances entre solidarité citoyenne et solidarité institutionnelle pour répondre aux besoins immédiats et futurs des personnes vulnérables et de leurs proches ?
1. Les besoins des personnes vulnérables et de leurs proches : entre Vie à tout prix et peur de l’abandon
Les aidants, qu’ils soient jeunes parents, conjoints ou enfants de personnes âgées, vivent des temporalités et des pressions différentes :
-
Les jeunes parents sont souvent animés par une « pulsion de vie » : confiant en l’avenir, ils veulent faire avancer les choses. Leur énergie est tournée vers le dynamisme, le possible, l’action, mais aussi vers la recherche de solutions pour les moments où ils ne peuvent pas être présents.
-
Les aidants plus âgés ou épuisés ressentent davantage le besoin d’être soulagés, d’organiser, d’anticiper le changement et la disparition :« Que risque mon proche si je suis absent, que deviendra -t-il quand je ne serai plus là ? ».
Un constat partagé : la qualité de vie des personnes vulnérables dépend de la présence permanente de personnes de confiance, qui s’entendent entre elles, agissent en coordination et sont soutenues par des institutions. Pourtant, ces cercles sont souvent informels, fragiles, et leur organisation reste un défi.
2. Le cercle de confiance : un modèle à renforcer
Un cercle de confiance efficace repose sur trois piliers :
-
Comprendre la personne vulnérable : prendre le temps de l’écouter, de connaître ses besoins, ses désirs, ses peurs.
-
Défendre et protéger : agir comme un rempart contre l’isolement, les abus, ou les lacunes du système.
-
S’occuper de la situation : aller chercher des compensations, mobiliser des ressources et les vérifier pour combler les manques.
Le défi : ces cercles existent souvent de manière naturelle, mais ils sont rarement formalisés, soutenus ou connectés aux institutions. Leur fragilité les expose à la disparition, notamment en cas de fatigue des aidants ou de changement de situation.
3. L’alliance entre solidarité citoyenne et institutionnelle : un impératif
Pour pérenniser ces cercles, il faut :
-
Créer des ponts entre les acteurs citoyens (familles, proches, voisins, bénévoles) et les acteurs institutionnels (établissements et professionnels de compensation, collectivités et institutions) ; avec en guise de ponts et de passerelles des professionnels de proximité en charge de s’occuper des situations pour garantir la centralité de la personne vulnérable au milieu du pont.
-
Formaliser des contrats de confiance : par exemple, des chartes ou contrat mixtes engageant les parties prenantes à collaborer.
-
Mobiliser des ressources autrement : communiquer sur un autrement, inventer et négocier de nouvelles relations, de nouvelles postures, de nouveaux pouvoirs.
Exemples inspirants :
-
Les cercles de soutien (comme ceux développés au Québec ou en Belgique) associent proches, voisins et professionnels autour d’un projet personnalisé.
-
Et d’autres dans le monde : Cercles de Soutien et de Responsabilité ; Voisins Solidaires ; Petits Frères des Pauvres ; Cercles de soutien communautaires ; Cercles de soutien pour personnes handicapées, âgées ;
-
Et les travaux du laboratoire d’idée Dediĉi – www.dedici.org : Triade d’autodétermination en triple expertise ; Petit toit ; Famille sociale étendue ; Cercle d’intimité et de confidences ; A trois pour dire Je. Après-Nous.
4. Agir maintenant : comment construire ces cercles ?
Pour passer de l’intuition à l’action, voici des pistes concrètes :
-
Organiser des sensibilisations régulières : pour renforcer la confiance, partager les informations, et ajuster les actions.
-
Identifier les personnes ressources : qui, dans l’entourage, peut s’engager ? Qui, parmi les professionnels, peut jouer un rôle de facilitateur ?
-
S’appuyer sur des outils existants : Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), ou encore les dispositifs de répit pour les aidants.
-
Demander un soutien institutionnel : solliciter les communes, les départements, ou les associations pour mobiliser et soutenir les acteurs de ces cercles. Demander une posture officielle de l’État pour rendre possible ce qui et nécessaire.
Un message clé : Ces cercles ne se construisent pas seuls. Ils ont besoin d’être reconnus, accompagnés et intégrés dans une démarche plus large de solidarité territoriale.
5. Conclusion : un appel à l’action collective
La vulnérabilité est un appel à l’innovation sociale. Les cercles de confiance, lorsqu’ils sont soutenus par des institutions et portés par des citoyens engagés, deviennent des leviers puissants pour prévenir l’isolement, améliorer la qualité de vie, et anticiper les transitions (vieillissement, handicap, fin de vie).
À nous de jouer : en tant qu’aidants, professionnels, élus ou simples citoyens, nous avons tous un rôle à jouer pour construire, dès aujourd’hui, ces alliances indispensables.