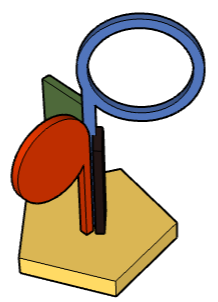Une seule question pour SOULAGER enfin les aidants
Pour ne plus proposer aux aidants des conseils sur comment porter leur charge, mais plutôt leur enlever ce fardeau, pour qu’ils puissent enfin souffler.
Le problème des aidants
Être aidant, c’est bien plus que s’occuper de quelqu’un. Ce n’est pas seulement l’aider à faire telle ou telle chose ou faire les choses à sa place. Pour beaucoup d’aidants, c’est aussi gérer tout ce qu’il y a autour en permanence : les tracas, les démarches, les complications. Et ça, c’est épuisant.
La réponse actuelle : On vous donne des conseils, des numéros « uniques » à appeler… pour finalement devoir appeler ailleurs. On vous propose des formations, on organise des tables rondes, des rencontres, des forums. On vous demande de vous déplacer, de prendre rendez-vous, de remplir des formulaires. On vous prend de haut et on vous use. Même pour obtenir un répit, ça commence toujours par plus de travail. Et ensuite, qu’est-ce qui change ? Résultat : au lieu de vous soulager, on vous fatigue encore plus, souvent pour de faux espoirs. Dans ces complications, même un professionnel aguerri ne s’en sort pas. Alors pourquoi l’exiger d’un aidant ?
Une seule question peut tout changer
Aujourd’hui, on vous pose mille questions. On vous demande de faire plein de démarches, mais c’est toujours la même chose, et il semble qu’on ne comprenne toujours rien.
Pourtant, on ne vous pose jamais la bonne question et, donc, on ne vous donne jamais de vraie solution. Nous, on veut poser une seule bonne question qui résume tout :
Est-ce que vous voulez que la solidarité prenne en charge, à votre place et de façon permanente, tous les tracas qui vous épuisent, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous ?
C’est la vraie question, mais on n’ose pas vous la poser, de peur que d’autres soient dans l’obligation de s’y coller.
Alors, est-ce que vous voulez qu’on vous soulage enfin et qu’on vous enlève tout ce qui est lourd à gérer, pour que vous puissiez passer plus de temps avec la personne que vous aidez, comme vous le souhaitez ?
Qu’est-ce que ça va changer ?
Si on met en place un système permanent qui prend en charge ces tâches à votre place :
-
Vous aurez plus de temps pour votre proche, pour être là quand il a vraiment besoin de vous.
-
Vous ne serez plus seul dans ce combat contre le système. Il y aura des gens pour vous épauler, en continu.
Ce que vous gardez
Évidemment, il y a des choses que vous voudrez peut-être continuer à faire vous-même, parce qu’elles sont importantes pour vous et pour la personne que vous protégez. Comme défendre ses droits ou lui accorder du temps et de l’attention.
Ce système vous laisse décider ce que vous voulez garder.
Conclusion
Ce qu’on propose, c’est de vous soulager réellement. Pas de vous laisser sous la charge avec des conseils ou des formations en vous disant d’appeler tel numéro, de visiter tel site ou de contacter tel organisme. On veut que vous puissiez déléguer ce qui vous épuise. On veut que vous puissiez enfin respirer et vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous.
Réfléchir à une réponse concrète : Comment ça pourrait se passer ?
Nous avons réfléchi à cette question unique et à la manière dont la solidarité pourrait proposer une réponse réaliste et durable pour soulager les aidants. Voici comment cela pourrait fonctionner :
L’idée est de mettre en place un système renforcé de proximité autour de la personne vulnérable, autrement dit une organisation permanente disposant de pouvoirs. Ce système fonctionnerait en lien étroit avec la personne, ses proches, et des professionnels, pour assurer un soutien complet et continu. L’objectif est de répartir les rôles et les responsabilités de façon claire, afin que chacun sache quoi faire, et que l’aidant ne soit plus seul à tout porter.
Comment cela s’organiserait ?
-
Les proches qui défendent et protègent : Ce rôle est essentiel. Les proches qui connaissent bien la personne vulnérable continueront à jouer ce rôle. Ils veilleront à ce que ses droits soient respectés et à ce qu’elle soit protégée dans les moments critiques.
-
Les professionnels qui s’occupent de la situation : La partie la plus lourde à gérer (démarches administratives, recherche de compensations, gestion des relations avec les institutions) serait déléguée à des professionnels disposant de prérogatives et de pouvoirs. Ces professionnels ne seraient pas là pour intervenir temporairement, mais pour assurer un accompagnement continu, en capitalisant sur leur connaissance de la situation. Ils auraient pour mission de chercher, négocier, mettre en place et évaluer les meilleures solutions en matière de solidarité. Ils seraient soutenus par le système de solidarité pour faire face à ses complications.
-
Les proches ou les professionnels qui interviennent pour la personne : Ils seraient en charge des aspects pratiques du quotidien, comme l’aide à la mobilité, la gestion des tâches de tous les jours, etc. Ces interventions se feraient en accord avec l’aidant et en coordination avec les professionnels.
Une organisation soutenue par le système
Tout cela ne fonctionnerait que si ce système de proximité est soutenu par la solidarité. Cela signifie que l’aidant, qui souvent joue trois rôles à la fois (protéger et défendre, s’occuper de la situation, et intervenir), pourrait choisir de se concentrer sur tout ou partie des rôles qu’il préfère. Par exemple, un aidant pourrait décider de se focaliser sur la protection et la défense des droits de son proche, et sur quelques interventions directes, tout en déléguant les tracas administratifs à des professionnels compétents.
Une démarche continue et permanente
Le but est de mettre en place une démarche continue et permanente avec des professionnels de proximité. Ces professionnels capitaliseraient leurs connaissances de la situation, ce qui signifie que vous n’auriez plus besoin de réexpliquer tout depuis le début à chaque changement d’interlocuteur. Ils travailleraient main dans la main avec vous et votre proche pour faire l’interface avec le système de solidarité, en assurant que tout ce qui peut être fait pour améliorer la situation soit fait de manière proactive.
Conclusion : Déléguer les tracas, garder l’essentiel
Ce système vous permettrait de déléguer toute la partie compliquée et chronophage liée aux démarches administratives et aux relations avec la solidarité. Vous seriez toujours en contrôle des aspects qui vous tiennent à cœur, comme la défense des droits de la personne que vous aidez, tout en sachant que des professionnels s’occupent de tout le reste, dans la durée, pour vous soulager.
Alors une seule question :
OUI ou NON, est-ce que vous voulez que la solidarité prenne en charge, à votre place et de façon permanente, tous les tracas qui vous épuisent, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous ?
Complément à l’article : Clarification de l’organisation proposée
Pour répondre à la question unique de savoir comment soulager réellement les aidants, il est essentiel de comprendre et de restructurer les rôles au sein de l’accompagnement des personnes vulnérables. Voici une proposition détaillée qui éclaire l’organisation nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans cette proposition le rôle 1 est tenu par la personne vulnérable.
1. Définir les rôles des aidants
Les aidants jouent en fait 3 rôles essentiels que la plupart des définitions n’intègrent pas ainsi :
-
Rôle 2 : Défense et protection de la personne vulnérable, veillant à la sauvegarde de ses droits et intérêts.
-
Rôle 3 : Gestion des démarches complexes, incluant la recherche de solutions, la négociation avec les institutions, et la mise en place des actions nécessaires.
-
Rôle 4 : Assistance pratique au quotidien, telles que les soins, l’accompagnement physique et les tâches ménagères.
Ces responsabilités cumulées peuvent rapidement devenir épuisantes pour les aidants, compromettant ainsi leur bien-être et l’efficacité de leur soutien.
2. Introduire le rôle central de la personne vulnérable
Au cœur de cette organisation se trouve naturellement la personne vulnérable (rôle 1). Toutes les actions doivent converger vers son bien-être, en respectant ses besoins et ses droits. La personne vulnérable est soutenue par une triade d’autodétermination, composée de :
-
Rôle 1 : La personne vulnérable.
-
Rôle 2 : Les aidants défenseurs et protecteurs.
-
Rôle 3 : Les professionnels spécialisés chargés des démarches complexes.
3. Renforcer le rôle 3 : Professionnalisation et nouveaux pouvoirs
L’innovation majeure consiste à professionnaliser et renforcer le rôle 3, en confiant ces tâches à des professionnels agueris. Ces acteurs doivent être reconnus officiellement par toutes les institutions de la solidarité (ARS, CEA, MDPH, Préfecture, établissements, etc.) comme les mandataires directs de la personne vulnérable et de ses proches. Ils disposeront de pouvoirs accrus pour :
-
Rechercher des solutions adaptées.
-
Négocier avec les institutions pour obtenir les meilleures compensations.
-
Mettre en place les actions nécessaires et évaluer leur efficacité.
Cette redistribution des pouvoirs permet aux aidants d’être soulagés et de se concentrer sur leur rôle de protecteurs (rôle 2) et/ou de conserver certaines tâches pratiques (rôle 4) selon leurs préférences, tout en délégant les démarches compliquées aux professionnels compétents.
4. Partager le rôle 4 : Assistance pratique par professionnels et bénévoles
Le rôle 4, qui concerne l’assistance pratique d’interventions quotidiennes, peut être partagé entre professionnels et bénévoles. Cela permet de libérer les aidants de certaines tâches physiques et logistiques, tout en maintenant une relation humaine et affective avec la personne vulnérable. Les professionnels et bénévoles devront accepter d’intervenir sous contrôle de manière efficace et harmonieuse, en respectant les dynamiques de l’organisation pilotée.
5. Soutien institutionnel continu (rôle 5)
Pour assurer le bon fonctionnement de cette organisation, les institutions (rôle 5) doivent apporter un soutien constant. Elles doivent :
-
Former et informer les acteurs sur les nouveaux rôles et responsabilités.
-
Médiation éthique pour résoudre les conflits d’intérêts et les tensions potentielles.
-
Garantir l’existence de la triade d’autodétermination grâce à un soutien permanent de cette famille sociale étendue pour chaque situation.
-
Arbitrer en dernier recours les complications entre les acteurs, en maintenant une cohésion globale.
6. Promotion de la lucidité et de l’intelligence collective
Une lucidité collective et une connaissance approfondie du processus sont indispensables pour que chaque acteur comprenne ses responsabilités à chaque instant. Un système d’information revisité doit être mis en place pour :
-
Faciliter la compréhension des rôles multiples que peuvent assumer les acteurs.
-
Assurer une intelligence collective permettant d’optimiser les actions et les interactions.
-
Maintenir une harmonie dans les relations entre les différents acteurs, évitant ainsi les chevauchements ou les interférences.
7. Encourager l’engagement des partenaires locaux
Pour surmonter les défis de la concurrence et des divergences d’intérêts, il est crucial de :
-
Mobiliser une volonté politique locale et associative.
-
Créer des réseaux de soutien basés sur des ententes locales avec des partenaires partageant les mêmes idéaux de solidarité.
-
Utiliser la couverture médiatique et politique pour rendre l’expérimentation attractive et novatrice, incitant ainsi les partenaires locaux à s’engager activement.
8. Institutionnalisation et législation future
À terme, cette expérimentation devra être institutionnalisée par l’adoption d’un Code de la solidarité opposable. Ce code garantirait la pérennité de l’organisation en la sanctuarisant par des textes de loi. Jusqu’à cette institutionnalisation, l’expérimentation devra s’appuyer sur un soutien temporaire puissant, issu de partenariats locaux et d’un réseau d’acteurs engagés.
Conclusion : Une organisation optimisée pour le bien-être des vulnérables et des aidants
Cette réorganisation innovante permet de redistribuer les rôles et les pouvoirs existants, sans nécessiter de nouvelles ressources humaines. En renforçant le rôle 3 des professionnels spécialisés et en permettant aux aidants de se concentrer sur leur rôle protecteur, tout en partageant les tâches pratiques avec des professionnels et bénévoles, on crée un système continu et cohérent. Soutenue par les institutions, cette triade d’autodétermination assure un accompagnement efficace et harmonieux, centré sur la personne vulnérable, tout en optimisant l’utilisation des ressources disponibles.
Cette solution répond de manière concrète à la question unique posée, en offrant un modèle basé sur l’optimisation organisationnelle et la redistribution des responsabilités et pouvoirs, garantissant ainsi le bien-être des aidants et des personnes vulnérables, tout en respectant les contraintes budgétaires et en mobilisant les ressources existantes de manière plus efficiente.