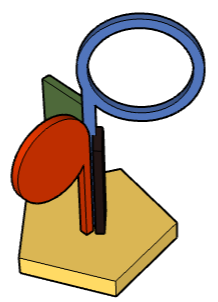On nous dit : « Il y a des dispositifs, Il y a des procédures, Il y a des professionnels formidables ».
Oui. Il y en a beaucoup. Et pourtant, quand ça brûle, quand une personne vulnérable est en difficulté, quand la vie quotidienne des aidants devient impossible, c’est toujours pareil :
Le système se protège, et nous on prend tout. Cela va-t-il finir ?
Le coup de gueule
Ce qu’on affronte, ce n’est pas “un manque de gens bien”
On croise nombre de personnes admirables. Mais ce n’est pas elles, le problème. Le problème, c’est l’organisme invisible qui vit au-dessus et les tient : un système qui a appris à survivre, à se couvrir, à se justifier, à se fragmenter.
Un système qui, face à la détresse, active un réflexe automatique : renvoyer plutôt que prendre en main, temporiser plutôt qu’agir, diluer plutôt qu’assumer, compliquer plutôt que simplifier, protéger ses périmètres plutôt que protéger la personne.
Ce n’est pas une intention méchante. C’est pire : c’est une défense réflexe, sans visage, sans aveu.
La première ligne, c’est nous
Pendant que “ça s’instruit”, nous : on gère les crises, on évite les catastrophes, on tient les nuits, les week-ends, les effondrements, on compense, on protège, on négocie, on supplie, on s’épuise.
Nous sommes la variable d’ajustement. Quand ça ne marche pas, c’est nous qui “complétons”. Quand c’est trop tard, c’est nous qui “avons mal fait”. Quand on craque, on devient un “cas”.
L’ultime n’est pas accessible. Mais le minimum, si.
Dediĉi parle de “défense ultime”. Soyons lucides : nous ne la connaîtrons jamais. Il y aura toujours de l’imprévu, des failles, du chaos possible. Mais ce constat ne justifie pas l’abandon organisé. Parce qu’entre “l’ultime” et le vide, il y a une marge énorme : celle où on peut s’approcher d’une vraie protection. Et cette marge, aujourd’hui, est gâchée.
Ce que Dediĉi met à nu : l’essentiel et l’aveuglement du système
Dediĉi a découvert un invariant : toutes les grandes misères finissent par venir des mêmes manques : pas de défense réelle, pas d’écoute réelle, pas de coordination réelle, pas de compensations fiables, pas de soutien institutionnel solide. Et cette évidence dérange.
Parce qu’elle révèle ceci : si ça échoue, ce n’est pas “fatal”. C’est structurel. Alors le système se défend. Il absorbe. Il neutralise. Il transforme l’innovation en papier. Il met un tampon sur la détresse.
Notre message est simple : protégez nos arrières.
Nous sommes en première ligne. Parents, proches, amis, aidants : nous tenons le front. Alors, au pays des bonnes intentions, nous faisons un appel :
Protégez nos arrières. Pas avec des slogans. Pas avec des comités. Pas avec une énième “orientation”. Avec une organisation qui tienne, qui dure, qui assume, qui protège vraiment. Une alliance qui ne lâche pas la personne. Un cercle de confiance réel, vivant, surveillé, soutenu.
On ne demande pas l’utopie. On demande que le système arrête de se défendre contre les situations, et commence enfin à se défendre pour les personnes. Parce qu’à force de nous laisser seuls au front, ce n’est pas seulement nous et nos proches qui tombons : c’est la dignité humaine.
En version “philosophique”
L’ultime est inaccessible. Et pourtant nous parlons de défense ultime.
Il y a une expérience étrange, quand on touche à l’essentiel : on croit voir clair… et l’on risque aussitôt de devenir aveugle.
Dediĉi a mis la main sur quelque chose de rare : un invariant, une ossature simple sous l’immense complexité des vies. Une manière de dire : si la solidarité échoue, ce n’est pas d’abord parce que les personnes sont mauvaises, mais parce que l’organisation manque aux endroits décisifs : écouter, protéger, s’occuper, compenser, soutenir.
Quand on voit cela, on peut avoir la tentation d’en faire une clé totale. Et c’est là que l’essentiel éblouit : il éclaire et il aveugle si l’on oublie ce qu’il ne dira jamais.
Car l’ultime, lui, reste inaccessible.
L’ultime : ce point qu’on ne possède jamais
Dans la vie humaine, il y a un horizon qu’on approche sans l’atteindre. La justice parfaite. La protection parfaite. La compréhension parfaite. La “bonne” décision sans reste, sans dommage collatéral.
La vulnérabilité le montre avec une brutalité particulière : il y aura toujours de l’imprévu, du fragilisé, du malentendu, du chaos possible. Et même quand tout est bien fait, il demeure un risque, une faille, une tristesse, un accident de l’existence.
Voilà pourquoi l’ultime est inaccessible. La vie excède nos systèmes.
Et pourtant, nous avons besoin de noms pour marcher. “Défense ultime” n’est pas un trophée qu’on brandit. C’est une étoile : on avance vers elle, en sachant qu’on ne la saisira pas.
Le paradoxe : un système peut se défendre contre la Vie
Autour des personnes vulnérables, nous rencontrons des professionnels admirables, des bénévoles magnifiques, des institutions peuplées d’humanité. Et malgré cela, quelque chose agit, impersonnel, sans intention claire : une forme d’auto-préservation du système.
Ce n’est pas un “méchant”. C’est un réflexe.
Le système, comme tout organisme, cherche sa survie : il se protège par ses procédures, ses périmètres, ses contraintes, ses prudences. Il se défend juridiquement, administrativement, budgétairement. Il se protège en se fractionnant.
Alors il arrive que la personne réelle — singulière, irréductible — devienne un “dossier”, un “flux”, une “orientation”. Non par cynisme, mais par “nature”.
La conséquence, elle, est concrète : quand le système se défend, il repousse la charge sur quelqu’un d’autre. Et cet autre, le plus souvent, c’est la famille ou l’humanité des aidants.
La première ligne : l’endroit où la vérité s’éprouve
La première ligne, ce n’est pas un slogan. C’est un lieu. C’est le domicile. C’est la nuit. C’est l’épuisement. C’est le moment où il faut protéger, calmer, décider, réparer, tenir… sans procédure, sans délai, sans relais.
La première ligne, c’est l’endroit où la solidarité n’est plus un concept mais une présence, ou son absence. Et c’est là que la phrase devient juste : Nous sommes en première ligne face à un système qui se défend.
L’essentiel découvert par Dediĉi et l’humilité nécessaire
Dediĉi a découvert l’essentiel : la solidarité tient (ou s’effondre) selon quelques fonctions vitales. Cette découverte est précieuse parce qu’elle simplifie sans trahir : elle donne une boussole.
Mais cette boussole exige une vertu : l’humilité. Car même si l’on organise mieux, même si l’on répare les cinq manques, on ne possédera jamais “la défense ultime” comme un état atteint une fois pour toutes.
Tout ce qu’on peut faire, c’est ceci : augmenter la protection, réduire les angles morts, donner du temps et de l’attention, tenir la continuité, empêcher que la personne soit seule, empêcher que la famille soit seule.
On s’approche. On ne conclut pas.
L’appel : “protégez nos arrières”
Si l’ultime est inaccessible, alors la grandeur n’est pas dans la victoire finale. Elle est dans l’alliance.
Nous, parents, proches, amis, aidants — au sens large : ceux qui, un jour, portent du rouge, du vert, du noir pour un bleu — nous sommes au front, nous sommes bleus.
Et ce que nous demandons n’est pas la perfection. Nous demandons un arrière. Un arrière qui n’abandonne pas. Un arrière qui ne se dissout pas. Un arrière qui ne disparaît pas quand la situation devient trop compliquée.
“Protégez nos arrières” signifie : assurez une présence qui dure, une organisation qui tienne, une continuité qui ne soit pas une promesse, une protection qui ne soit pas seulement juridique, une solidarité qui n’oublie pas la personne réelle.
Car l’ultime est inaccessible. Mais s’en approcher, ensemble, c’est possible. Et peut-être est-ce cela, au fond, la seule définition réaliste de la défense ultime :
Une société qui ne laisse plus jamais seuls tout ceux (citoyens, familles, bénévoles et professionnels) qui protègent et s’occupent activement et durablement de chaque situation, de chaque personne vulnérable en besoin de solidarité.