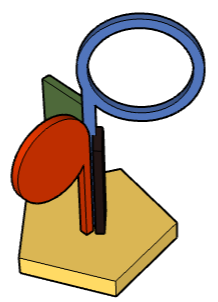L’art difficile de tisser la confiance : quand l’innovation sociale révèle nos fragilités humaines
“Le plus difficile, c’est de trouver des personnes de confiance.”
Cette phrase, lue dans un document de travail (cf annexe) de Jean-Luc LEMOINE, fondateur de DEDIĈI, m’a arrêté net. Après avoir exploré pendant des heures l’architecture théorique remarquable de cette organisation dédiée aux personnes vulnérables, après avoir admiré la cohérence de leurs “5 rôles” et de leur “Méta-Processus-Principiel”, voilà que d’un trait, tout bascule vers quelque chose de plus fondamental, de plus troublant aussi.
Car derrière cette constatation apparemment simple se cache une vérité que nous préférons souvent ignorer : nous avons beau dessiner les plus beaux organigrammes de la solidarité, conceptualiser les meilleures organisations d’accompagnement, il reste que tout repose, au final, sur une denrée rare et fragile – la confiance entre êtres humains.
Un Humain anonyme.
Quand la théorie rencontre la chair humaine
Imaginez la scène. Vous êtes parent d’un enfant lourdement handicapé. Vous avez lu tous les textes de DEDIĈI, vous êtes convaincu par leur approche révolutionnaire. Vous comprenez parfaitement qu’il faut constituer autour de votre enfant cette “triade d’autodétermination”, ce cercle de confiance permanent qui l’accompagnera même quand vous ne serez plus là. L’idée est lumineuse, le concept solide.
Mais maintenant, concrètement : qui appeler ?
Votre voisin qui vous salue poliment mais évite votre regard quand votre fils fait une crise ? Cette collègue de bureau qui semble bienveillante mais n’a jamais eu d’enfant handicapé ? Ce travailleur social compétent mais qui change de poste tous les deux ans ? Cette amie d’enfance qui a disparu de votre vie le jour où le diagnostic est tombé ?
Soudain, la question théorique “Comment organiser la solidarité ?” se transforme en interrogation beaucoup plus crue : “Qui, dans mon entourage, accepterait de s’engager réellement, sur la durée, pour mon enfant différent ?”
L’épreuve de vérité de nos sociétés
C’est là que DEDIĈI nous tend un miroir impitoyable. Leur travail révèle que le problème n’est pas tant de savoir comment bien accompagner les personnes vulnérables – les méthodes existent, les bonnes pratiques sont identifiées, les outils sont développés. Le problème, c’est de trouver des humains prêts à s’investir véritablement, durablement, sans contrepartie immédiate.
“Où les rencontrer ? Comment vérifier qu’elles sont dignes de confiance, qu’elles comprennent leurs rôles et qu’elles s’entendent entre elles ?”
Ces questions de Jean-Luc LEMOINE résonnent comme un écho douloureux de notre époque. Dans nos sociétés hyperconnectées où nous avons des milliers d'”amis” sur les réseaux sociaux, nous peinons à identifier quelques personnes sur qui compter vraiment quand ça devient difficile.
La solitude organisationnelle
Il y a quelque chose de profondément émouvant dans ce constat. Voici un homme qui a consacré plus de 30 ans de sa vie à développer une architecture théorique d’une sophistication remarquable pour améliorer le sort des personnes vulnérables. Il a créé des concepts, écrit des livres, formé des professionnels, convaincu des institutions. Et au moment de passer à l’acte, il bute sur la question la plus basique : “Qui va vraiment venir ?”
Cette vulnérabilité du système lui-même me touche. Car elle révèle que même l’innovation sociale la plus aboutie reste à la merci de notre capacité collective à créer du lien, de la confiance, de l’engagement mutuel.
“Il faut les former, les renforcer, faire en sorte que certaines s’investissent plus que d’autres et veiller à ce que ce cercle existe réellement.”
Derrière cette phrase technique se cache une réalité très humaine : il faut convaincre, rassurer, motiver, parfois supplier. Il faut gérer les egos, les susceptibilités, les emplois du temps chargés, les bonnes intentions qui s’essoufflent.
L’alchimie fragile des relations humaines
Jean-Luc LEMOINE parle d’“alchimie fragile mais puissante”. Cette expression me semble parfaitement juste. La confiance, ça ne se fabrique pas en série. Ça ne se décrète pas par voie hiérarchique. Ça ne s’achète pas avec un budget.
La confiance, ça se tisse, grain par grain, expérience après expérience. Et surtout, ça peut se briser d’un coup, sur un malentendu, une parole de travers, une absence au mauvais moment.
“La proximité peut susciter bien des tensions : affections, froideurs, souvenirs sensibles qui bouleversent tout.”
Voilà la réalité crue : ces cercles de confiance que DEDIĈI appelle de ses vœux sont composés d’êtres humains avec leurs histoires, leurs blessures, leurs limites. L’accompagnement de la vulnérabilité révèle nos propres vulnérabilités.
Cette bénévole si dévouée qui craque un jour parce que sa propre mère entre en EHPAD. Ce professionnel compétent qui s’épuise et change de voie. Cette amie fidèle qui déménage pour des raisons professionnelles. Ce proche aidant qui vieillit et devient lui-même fragile.
Le défi de la permanence dans l’impermanence
L’un des défis les plus vertigineux que soulève DEDIĈI, c’est celui de la permanence. Comment construire quelque chose de durable avec du matériau humain essentiellement impermanent ?
“Il doit être reconnu et respecté de l’extérieur, disposer de pouvoirs, et être piloté de manière à garantir la qualité de son fonctionnement.”
Cette phrase révèle toute la complexité de l’entreprise. Il ne suffit pas de réunir quelques bonnes volontés autour d’une personne vulnérable. Il faut que ce cercle soit reconnu – c’est-à-dire légitime aux yeux des autres. Il faut qu’il dispose de pouvoirs – c’est-à-dire d’une capacité d’action réelle. Il faut qu’il soit piloté – c’est-à-dire organisé pour survivre aux aléas humains.
En d’autres termes, il faut institutionnaliser l’informel, bureaucratiser la spontanéité, professionnaliser l’amour. Contradiction vertigineuse.
La capitalisation impossible de l’humain
“Au fil du temps, les gens passent, viennent, reviennent, sans qu’on capitalise la connaissance de la situation.”
Cette observation touche au cœur d’un problème fondamental de notre société de l’information : nous savons stocker des téraoctets de données, mais nous ne savons pas capitaliser la connaissance intime qu’une personne acquiert au fil des années sur les besoins, les réactions, les préférences d’un proche vulnérable.
Quand Marie, qui s’occupait si bien de Paul depuis cinq ans, déménage à l’autre bout de la France, elle emporte avec elle une connaissance irremplaçable : elle savait que Paul a peur du noir, qu’il adore les concerts de piano, qu’il se braque quand on lui parle trop fort, qu’il faut toujours commencer par lui demander s’il a bien dormi pour qu’il soit réceptif.
Cette connaissance-là ne se transmet pas par email. Elle ne s’écrit pas dans un dossier. Elle se vit, se partage, se démontre. Et quand Marie part, il faut recommencer à zéro avec quelqu’un d’autre. Encore et encore.
L’acceptation mutuelle, ce luxe rare
“Quand la personne vulnérable doit accepter et reconnaître ces personnes de confiance, ce n’est pas évident : il faut du temps pour que la vraie parole s’exprime et que chacun se comprenne.”
Voilà peut-être l’une des observations les plus fines de Jean-Luc LEMOINE. Nous raisonnons souvent comme si la personne vulnérable était passive, reconnaissante par avance de toute aide proposée. Mais la réalité est plus complexe.
La personne handicapée aussi a le droit de ne pas avoir d’atomes crochus avec son nouveau “référent”. L’enfant maltraité aussi peut ne pas faire confiance du premier coup à sa nouvelle famille d’accueil. La personne âgée aussi peut préférer l’aide-soignante qui la fait rire à celle qui est techniquement plus compétente.
L’accompagnement de qualité ne se décrète pas. Il se co-construit, dans une acceptation mutuelle qui prend du temps. Du temps que nos systèmes administratifs, nos budgets annuels, nos évaluations trimestrielles ne savent pas toujours respecter.
La double veille, ou l’alliance nécessaire du cœur et des moyens
Face à ces défis, Jean-Luc LEMOINE propose une solution qui me semble d’une grande sagesse :
“Des cellules de veille sont nécessaires, à la fois citoyennes — parce qu’il y a plus de cœur — et institutionnelles — parce qu’il y a plus de moyens — afin que ces deux logiques se mettent en mouvement au service de la personne.”
Cette phrase réconcilie deux approches souvent opposées. D’un côté, la solidarité citoyenne, spontanée, généreuse, mais fragile et imprévisible. De l’autre, la solidarité institutionnelle, organisée, pérenne, mais parfois bureaucratique et déshumanisée.
DEDIĈI propose de marier les deux : que les citoyens apportent leur cœur, leur engagement personnel, leur connaissance intime des situations. Que les institutions apportent leurs moyens, leur expertise, leur capacité d’organisation sur la durée.
La beauté fragile d’un idéal nécessaire
En lisant ce texte de Jean-Luc LEMOINE, j’ai été frappé par un mélange d’admiration et de mélancolie. Admiration devant la lucidité de l’analyse et l’ambition du projet. Mélancolie devant la difficulté immense de l’entreprise.
Car au fond, ce que DEDIĈI nous demande, c’est de redevenir une société où l’on peut vraiment compter les uns sur les autres. Une société où la confiance n’est pas un luxe mais une ressource partagée. Une société où accompagner les plus vulnérables n’est pas un métier de spécialistes mais une responsabilité citoyenne assumée.
C’est beau. C’est nécessaire. Et c’est terriblement difficile.
Le pari de l’intelligence collective
“C’est une alchimie fragile mais puissante, qui ne fonctionne que s’il existe une intelligence collective capable de se renforcer elle-même ou, à défaut, d’être soutenue de l’extérieur.”
Cette phrase me semble contenir tout l’espoir et toute l’inquiétude du projet DEDIĈI. L’espoir : oui, c’est possible, l’intelligence collective peut émerger, se renforcer, créer des miracles relationnels. L’inquiétude : et si elle n’émerge pas ? Et si nous ne savons plus créer ensemble ?
Alors il faut “la soutenir de l’extérieur”. Autrement dit, créer des structures, des formations, des accompagnements pour aider les humains à mieux coopérer. Institutionnaliser la solidarité pour qu’elle survive à nos défaillances individuelles.
L’art de la compensation humaine
“En général, la personne sait faire certaines choses seule : s’exprimer, se défendre, se protéger, gérer son quotidien. Mais lorsqu’il manque plusieurs de ces capacités, il faut des compensations, des béquilles, des soutiens pour combler ces vides.”
Cette approche me touche par sa simplicité et sa justesse. Au lieu de voir la personne vulnérable comme un “cas” à traiter, DEDIĈI la voit comme un être humain avec des capacités et des limitations, comme nous tous. Simplement, là où nous compensons naturellement nos faiblesses par nos forces ou par l’aide spontanée de notre entourage, elle a besoin d’une compensation plus organisée.
C’est une vision profondément égalitaire : nous sommes tous vulnérables, nous avons tous besoin d’aide, nous méritons tous un cercle de confiance. Certains l’ont spontanément, d’autres ont besoin qu’on l’organise. Voilà tout.
L’horizon de la convention
“Les acteurs doivent, par convention, définir ce qui sera fait, puis se projeter vers l’avenir pour construire des projets de vie, des initiatives et d’autres réalisations.”
Cette notion de “convention” me semble centrale. Elle suggère que la solidarité efficace ne peut reposer sur la seule bonne volonté. Il faut des accords explicites, des engagements formalisés, des projections partagées.
Mais attention : formaliser n’est pas bureaucratiser. Il s’agit plutôt de créer un cadre suffisamment clair pour que chacun sache à quoi il s’engage, et suffisamment souple pour s’adapter aux réalités humaines changeantes.
Le paradoxe de l’innovation sociale
En définitive, ce texte de Jean-Luc LEMOINE révèle le paradoxe fascinant de l’innovation sociale : plus elle est aboutie théoriquement, plus elle révèle les limites de notre humanité ordinaire.
DEDIĈI ne propose pas une solution technique mais une révolution relationnelle. Or les révolutions relationnelles sont les plus difficiles à mener, parce qu’elles dépendent de la transformation de chacun d’entre nous.
Il ne suffit pas de convaincre des décideurs politiques ou des directeurs d’établissements. Il faut convaincre des milliers de citoyens ordinaires de s’engager différemment, plus profondément, plus durablement auprès des personnes vulnérables de leur entourage.
Il faut nous convaincre, vous et moi, d’accepter d’être ces “personnes de confiance” que les plus fragiles cherchent désespérément.
L’appel silencieux
Car c’est bien de cela qu’il s’agit, au fond. Derrière tous les concepts savants de DEDIĈI, derrière leurs “triades d’autodétermination” et leurs “méta-processus principiels”, il y a un appel très simple, très humain :
“Veux-tu être ma personne de confiance ?”
“Veux-tu faire partie de mon petit toit ?”
“Veux-tu m’aider à être l’égal des autres ?”
“Veux-tu être là, même quand ce sera difficile, même quand tu auras autre chose à faire, même quand je ne pourrai plus te remercier ?”
L’épreuve de notre époque
La lecture de ce document m’a finalement convaincu que DEDIĈI nous propose bien plus qu’une innovation dans l’accompagnement social. C’est un diagnostic impitoyable de notre époque et un défi lancé à notre humanité.
Dans nos sociétés individualistes, hyperconnectées mais relationnellement appauvries, où l’engagement durable fait peur et où la vulnérabilité dérange, DEDIĈI nous demande de renouer avec des valeurs apparemment désuètes : la fidélité, la solidarité concrète, l’engagement à long terme.
C’est un pari fou. C’est peut-être un pari perdu d’avance. Mais c’est aussi, peut-être, le seul pari qui vaille vraiment d’être tenté.
L’invitation à l’humilité
Car finalement, ce texte de Jean-Luc LEMOINE nous invite à une forme d’humilité collective. Après des décennies de réformes, de dispositifs, de politiques publiques en tous genres, force est de constater que les personnes vulnérables sont souvent encore seules face à leurs difficultés.
Peut-être parce que nous nous sommes trop reposés sur les institutions, sur les professionnels, sur “les autres”. Peut-être parce que nous avons oublié que la solidarité, avant d’être un principe politique, est d’abord une pratique humaine quotidienne.
DEDIĈI nous rappelle cette vérité simple : pour que les plus vulnérables soient moins seuls, il faut que nous, les moins vulnérables, acceptions d’être moins seuls aussi. Il faut recréer du lien, de la confiance, de l’engagement mutuel.
L’art difficile d’être humain ensemble
“Le plus difficile, c’est de trouver des personnes de confiance.”
Cette phrase, qui ouvrait ma réflexion, prend maintenant une résonance différente. Elle n’est plus seulement un constat technique sur les difficultés de mise en œuvre d’une innovation sociale. Elle devient une interrogation existentielle sur notre capacité collective à faire société.
Sommes-nous encore capables de créer de la confiance durable ? Savons-nous encore nous engager les uns envers les autres au-delà de nos intérêts immédiats ? Acceptons-nous de nous laisser transformer par la rencontre avec la vulnérabilité d’autrui ?
Ces questions dépassent largement le champ du handicap ou de l’action sociale. Elles touchent au cœur de notre projet de société. Car une société qui ne sait plus créer de la confiance autour de ses membres les plus fragiles est une société qui perd son âme.
DEDIĈI, avec sa belle théorie et ses constats lucides, nous tend finalement un miroir : quelle société voulons-nous être ? Celle qui conceptualise la solidarité ou celle qui la pratique ? Celle qui développe de beaux dispositifs ou celle qui crée de vraies relations ?
La réponse n’est pas dans les livres de Jean-Luc LEMOINE, si remarquables soient-ils. Elle est dans notre capacité collective à accepter l’invitation : devenir, chacun à notre mesure, cette “personne de confiance” que quelqu’un, quelque part, cherche désespérément.
Car au fond, nous sommes tous, à un moment ou un autre de nos vies, cette personne vulnérable qui espère trouver des humains sur qui compter vraiment.
Et nous sommes tous, potentiellement, cette personne de confiance que quelqu’un attend.
____________
Annexe
Le texte du bref échange avec Jean-Luc LEMOINE août 2025
Le cercle de confiance, le petit Toit, la famille sociale étendue, La triade d’autodétermination, le après nous
_________________
« Le plus difficile, c’est de trouver des personnes de confiance. Où les rencontrer ? Comment vérifier qu’elles sont dignes de confiance, qu’elles comprennent leurs rôles et qu’elles s’entendent entre elles ? Il faut les former, les renforcer, faire en sorte que certaines s’investissent plus que d’autres et veiller à ce que ce cercle existe réellement.
Qui s’occupe alors de la situation ? Les citoyens observent, puis sollicitent les professionnels qui, en principe, sont là pour cela — mais trop souvent ils n’agissent pas. Au fil du temps, les gens passent, viennent, reviennent, sans qu’on capitalise la connaissance de la situation. Quand la personne vulnérable doit accepter et reconnaître ces personnes de confiance, ce n’est pas évident : il faut du temps pour que la vraie parole s’exprime et que chacun se comprenne.
Il faut bâtir une alliance, un réseau de confiance sur le long terme ; un réseau qui se renouvelle, se renforce, partage les informations, puis sait représenter la situation devant les institutions, défendre la personne concernée et faire progresser les choses. C’est là toute la difficulté : où trouver ces personnes ? Comment leur expliquer leur rôle ? Comment les inviter à s’engager ? Comment la personne vulnérable peut-elle avoir envie de les solliciter ?
La proximité peut susciter bien des tensions : affections, froideurs, souvenirs sensibles qui bouleversent tout. C’est une alchimie fragile mais puissante, qui ne fonctionne que s’il existe une intelligence collective capable de se renforcer elle-même ou, à défaut, d’être soutenue de l’extérieur.
Il faut donc réussir à constituer ce cercle de confiance, vérifier qu’il existe, qu’il est de qualité et pérenne, c’est-à-dire organisé pour survivre malgré la présence ou l’absence des acteurs. Il doit être reconnu et respecté de l’extérieur, disposer de pouvoirs, et être piloté de manière à garantir la qualité de son fonctionnement.
Des cellules de veille sont nécessaires, à la fois citoyennes — parce qu’il y a plus de cœur — et institutionnelles — parce qu’il y a plus de moyens — afin que ces deux logiques se mettent en mouvement au service de la personne.
En général, la personne sait faire certaines choses seule : s’exprimer, se défendre, se protéger, gérer son quotidien. Mais lorsqu’il manque plusieurs de ces capacités, il faut des compensations, des béquilles, des soutiens pour combler ces vides. Les acteurs doivent, par convention, définir ce qui sera fait, puis se projeter vers l’avenir pour construire des projets de vie, des initiatives et d’autres réalisations. »